
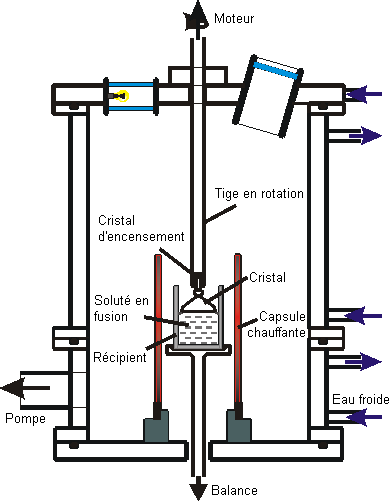
I - Croissance à partir de la phase fondue
1 ) Croissance en solution au voisinage de la température ambiante et à presion atmosphérique
2 ) Croissance en solution à haute température et à pression atmosphérique (flux)
La nature du matériau à élaborer conditionne pour une grande part la technique de cristallogenèse à utiliser : si le matériau ne possède pas de transition de phase ou s'il est stable jusqu'à sa fusion, il est généralement possible d'entreprendre la croissance cristalline directement à partir du matériau fondu ou de sa phase vapeur ; dans le cas contraire la cristallogenèse nécessite l'utilisation d'un solvant, ce qui constitue un degré de difficulté supplémentaire. Indépendamment des considérations de fusion et de transition de phase, un matériau pourra nécessiter une croissance sous haute pression, sous vide, sous atmosphère contrôlée ou en ampoule scellée, ce qui rend les dispositifs encore plus lourds. D'un point de vue général, la cristallogenèse nécessite une étude préalable des conditions thermodynamiques de synthèse, à savoir composition chimique, température et pression, sur la base de banques de données et d'expériences spécifiques. La préparation des réactifs, qui est spécifique à chaque technique, est généralement une étape importante de l'élaboration. L'obtention de cristaux de grande dimension et de haute qualité nécessite des compétences en mécanique des fluides et en cinétique, de même qu'elle requiert la mesure de nombreux paramètres physico-chimiques comme la viscosité par exemple. Il est à noter que la communauté scientifique franšaise délaisse la cristallogenèse de cristaux massifs de grande dimension, en raison notamment du coût très élevé de ces opérations.
Nous présentons ici les principales techniques de cristallogenèse utilisées actuellement pour les monocristaux massifs : il s'agit principalement de croissance à partir de la phase fondue ou en solution. La croissance est réalisée sur germes orientés. Les autres méthodes de croissance cristalline, comme la méthode en phase gazeuse par exemple, sont plus rarement utilisées dans le domaine des cristaux massifs.
Cette technique haute température, jusqu'à 2000░C, est particulièrement bien adaptée à la croissance de composés semi-conducteurs, oxydes ou fluorures minéraux pour lesquels la phase fondue ne nécessite pas de conteneur étanche. C'est la méthode employée industriellement pour le titrage du silicium, du germanium, et également pour certains oxydes ou fluorures minéraux à propriétés optiques comme LiNbO3 ou les matrices lasers de YAG (Y3Al5O12), de saphirs, de YLiF4 et de Ca4TRO(BO3)3. Cette technique, dont la difficulté majeure est la maîtrise des hautes températures, permet d'obtenir de très gros volumes avec des vitesses de croissance élevées.

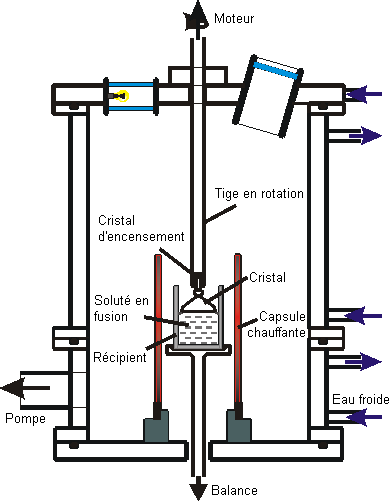

Cristal de GaAs obtenu grâce à la méthode Czochralski
Cette méthode repose également sur la technologie des hautes températures, avec des températures de travail comprises entre 400 et 1400░C. Elle est utilisée pour les composés dont la phase fondue est toxique ou très réactive vis-à-vis de l'air ou présente une forte tension de vapeur : la croissance est alors réalisée en ampoule scellée, ce qui constitue une difficulté supplémentaire par rapport à la technique Czochralski. Elle est utilisée pour la croissance de certaine semi-conducteurs pour l'optique comme GaAs, AgGaS2, AgGaSe2, GaSe, Tl3AsSe3, ainsi que pour les halogénures alcalins comme CaF2 et MgF2.

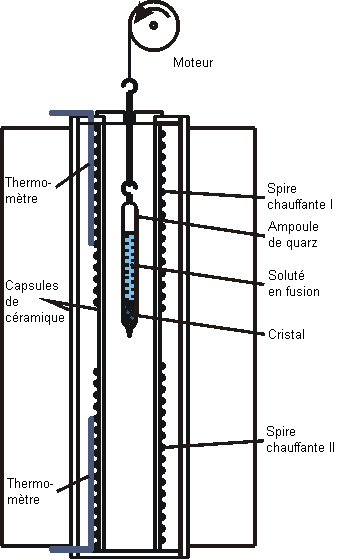
C'est la situation la plus favorable pour la cristallogenèse en solution. Elle est adaptée aux cristaux à basse température de fusion comme les composés organiques (qui contiennent du carbone, comme POM, NPP), organominéraux (2A5NPDP), et certains sels minéraux comme KDP. Cette méthode permet l'obtention de gros volumes de matière avec des vitesses de croissance élevées. En France, cette technique n'est plus maîtrisée que par très peu d'équipes.
La méthode des flux s'apparente à la technique Czochralski, la différence essentielle tenant à la dissolution du composé dans un solvant. Les températures n'excèdent généralement pas 1400░C. C'est une méthode utilisée pour les oxydes minéraux à fusion non congruente comme KTiOPO4, BaTiO3, LiB3O5, ou à fusion congruente comme BaB2O4 et YAl3(BO3)4 par exemple. La méthode des flux nécessite une connaissance extrêmement précise des diagrammes de phase afin d'éviter la cristallisation de phases parasites qui rendent sa mise en œuvre plus délicate que la technique Czochralski. C'est peut-être ce qui explique que peu de laboratoires maîtrisent cette méthode.
C'est une méthode qui permet également de travailler au voisinage de la température ambiante. Le solvant est un milieu gélifié dont l'avantage est l'obtention de cristaux de très bonne qualité du fait d'un régime de croissance purement diffusif. Cette technique peut être utilisée pour la croissance de composés organiques et organominéraux, mais également pour certains minéraux. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne permet pas dans l'état actuel des choses de produire des cristaux de grande dimension car les réacteurs de croissance ont un volume limité à quelques dizaines de cm3, ce qui correspond au volume typique pour lequel un gel est homogène. Cette technique est surtout employée pour les films minces ; son avenir pour les cristaux massifs dépendra de l'augmentation du volume réactionnel compatible avec une bonne homogénéité de composition.
La croissance hydrothermale est probablement la technique la plus délicate à mettre en œuvre car il faut être capable de gérer non seulement des températures relativement hautes (plusieurs centaines de degrés Celsius), mais également des pressions élevées qui peuvent attendre plusieurs centaines d'atmosphère. C'est la méthode de croissance du quartz et des cristaux du même type.